Patrimoine - N°101 - Juillet/Août 2009
L’amer veille à Vallières
Les pilotes
des stations de Royan et de Saint-Georges demandent en 1823 la
construction d’un amer sur la pointe de Vallières afin
de faciliter leur navigation sur la Gironde et
d’éviter notamment des bancs de sable. Un mur imposant
est alors visible et demeure jusque dans les années
60.
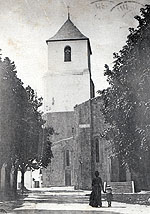 Repère fixe sur la côte, identifiable et
identifié, l’amer est utilisé par les
navigateurs pour se repérer d’assez près
pendant le jour et ainsi reconnaître ou rectifier une
position géographique. Il est au jour ce que le phare est
à la nuit. Les amers constituent un des trois types de
balisage du littoral avec les balises et les bouées. On en
distingue trois types. Le premier consiste en des repères
naturels tels de grands arbres ou des rochers de forme atypique. Le
second type d’amer est un objet artificiel souvent
remarquable par sa dimension, facilement identifiable pendant le
jour pour le navigateur et apte à caractériser une
partie de la côte mais n’ayant pas cette fonction
principale. Ce sont par exemple les clochers
d’églises.
Repère fixe sur la côte, identifiable et
identifié, l’amer est utilisé par les
navigateurs pour se repérer d’assez près
pendant le jour et ainsi reconnaître ou rectifier une
position géographique. Il est au jour ce que le phare est
à la nuit. Les amers constituent un des trois types de
balisage du littoral avec les balises et les bouées. On en
distingue trois types. Le premier consiste en des repères
naturels tels de grands arbres ou des rochers de forme atypique. Le
second type d’amer est un objet artificiel souvent
remarquable par sa dimension, facilement identifiable pendant le
jour pour le navigateur et apte à caractériser une
partie de la côte mais n’ayant pas cette fonction
principale. Ce sont par exemple les clochers
d’églises.
Enfin, il y a la construction de monuments ayant comme unique fonction l’aide à la navigation. C’est précisément ce type de construction auquel correspond l’amer de Vallières édifié au cours de la première moitié du xixe siècle. C’est durant cette période que les côtes de France sont méthodiquement sondées afin de déterminer avec précision les chenaux de navigation, repérer les hauts-fonds et par là même mieux les baliser ou les éclairer. Cette gigantesque tâche incombe à Beautemps-Beaupré qui, à partir de 1816, commence l’étude complète de l'hydrographie des côtes françaises. Il aura fallu attendre la Révolution française pour qu’une administration particulière soit créée le 15 septembre 1792 avec la surveillance des phares, amers, et balises dépendant du ministère de la Marine. Mais la fréquentation de plus en plus importante des routes maritimes incite Napoléon ier à confier ce travail à un service spécifique de la Direction générale des Ponts & Chaussées, le bureau des phares et balises, créé à cette fin le 7 mars 1806. C’est dans ce contexte général d’amélioration du balisage des côtes et des estuaires que se réunit le 28 juin 1823 sous l’autorité du préfet une Commission d’officiers désignés par M. le Contre Amiral Commandant de la Marine du département de Rochefort. Ils sont chargés d’examiner les demandes des pilotes des stations de Royan et de Saint-Georges qui réclament «la construction d’un pan de mur à la place des ruines de l’ancien corps de garde de la pointe de Vallière» permettant de mieux caractériser la côte et d’aider à la navigation souvent difficile à cet endroit. La Commission reconnaît le bien fondé d’une telle requête et décide qu’un mur serait établi «dans la direction ouest- sud-ouest et est-nord-est sur l’emplacement de l’ancien corps de garde écroulé et aurait 4 mètres de largeur sur 5 mètres de hauteur au sommet du fronton.» Un amer répondant à cette description est érigé au lieu convenu mais ses dimensions et son orientation se révèlent mal évaluées et inadaptées. Il ne remplit pas efficacement ses fonctions d’aide à la navigation dans cette partie de la Gironde. C’est pourquoi, une nouvelle commission se réunit le 21 novembre 1827 sous la présidence du conducteur de la subdivision de Royan et en présence de pilotes des deux stations de Royan et de Saint-Georges ainsi que du maître de port de Royan. Elle examine le projet d’un surhaussement de 5 mètres à faire en charpente à l’amer de Vallières dans le but de le rendre plus visible. Les pilotes des différentes stations déclarent alors que «par ce surhaussement, le-dit amer acquerrait une hauteur assez considérable pour dominer les terres qui l’avoisinent et parmi lesquelles il paraît à peine, mais que la direction de sa façade restant la même, elle n’offrirait pas assez de développement pour être aperçue de très loin parce que la dite façade n’étant pas assez incliné de l’est dans le sud on ne peut, étant dans le haut de la rivière, qu’en apercevoir une petite partie.»
 Ils réclament la construction d’un nouvel amer
à la pointe de Vallières sur un nouvel emplacement.
L’amer projeté doit être suffisamment
élevé à une hauteur totale de 8 mètres,
que le côté est de sa façade soit porté
de 30° plus dans la direction du sud et enfin que les
dimensions de la-dite façade dans sa nouvelle direction soit
plus large de deux mètres pour atteindre six mètres
de largeur. Une décision tarde à venir et il faut
attendre quatre années pour qu’une nouvelle commission
se réunisse afin de définir l’emplacement et le
lieu précis du nouvel amer. Cette rencontre a lieu le 24 mai
1831 et définit «l’emplacement à adopter
lequel emplacement nous avons trouvé convenablement
situé à l’endroit où est placée
une balise provisoire qui avait été mise par les
soins du conducteur sur le point le plus élevé de la
pointe de Vallières». Le nouveau mur se situe alors en
haut de l’actuelle rue de la Vigie sur la pointe de
Vallières, «les pilotes soussignés ayant
déclaré unanimement que le déplacement du
susdit amer de Vallières ne nuirait en rien à la
direction qu’il indique pour éviter le banc des Jeaux,
pourvu que sa nouvelle position se trouve bien dans la ligne
déterminée par le clocher de Saint-Pierre de
Royan.» La reconstruction du nouvel amer est engagée
l’année suivante. Un magnifique plan de la pointe de
Vallières, rehaussé de couleurs et datant de 1837 est
conservé dans le fonds du Service maritime aux archives
départementales de la Charente-Maritime permettant comme
l’indique sa légende de faire connaître la
position actuelle de l’amer de Vallières tant par
rapport à la jetée de Saint-Georges que par rapport
à l’emplacement de l’ancien amer. En 1853, le
mur doit être peint conformément à la
circulaire du ministre des Travaux Publics en date du 24 septembre.
La surface à blanchir est de 72 m2. Un tableau
dressé par l’ingénieur de la subdivision de la
Gironde, chargé de dresser un inventaire exhaustif des amers
de l’estuaire, indique en 1854 que l’amer de
Vallières, décrit comme une muraille en pierres de
taille, fait partie des cinq principaux amers de cette côte
de Gironde pour aider les navigateurs. Les autres points de
repères sont, d’ouest en est, l’amer de Terre
Nègre (tour en maçonnerie), le clocher de
l’ancienne église de Saint-Palais, l’amer du
Chai (tour en maçonnerie) et le clocher de
l’église de Royan. En 1869, un fort coup de vent
renverse l’amer. Il est aussitôt reconstruit
grâce au budget affecté au service du balisage de la
Gironde, preuve s’il en est que ce mur est important pour les
pilotes de l’estuaire. Le registre de balisage, dressé
en 1891, par l’ingénieur ordinaire des Ponts &
Chaussées, département des Phares et Balises de
l’arrondissement de Royan, et conservé aux archives
départementales, présente l’inventaire des
différents balisages le long de la rive droite de la Gironde
sous la forme d’un très joli cahier de dessins des
différentes balises et amers présents sur ces
côtes. Le mur de Vallières et ses dimensions y sont
Ils réclament la construction d’un nouvel amer
à la pointe de Vallières sur un nouvel emplacement.
L’amer projeté doit être suffisamment
élevé à une hauteur totale de 8 mètres,
que le côté est de sa façade soit porté
de 30° plus dans la direction du sud et enfin que les
dimensions de la-dite façade dans sa nouvelle direction soit
plus large de deux mètres pour atteindre six mètres
de largeur. Une décision tarde à venir et il faut
attendre quatre années pour qu’une nouvelle commission
se réunisse afin de définir l’emplacement et le
lieu précis du nouvel amer. Cette rencontre a lieu le 24 mai
1831 et définit «l’emplacement à adopter
lequel emplacement nous avons trouvé convenablement
situé à l’endroit où est placée
une balise provisoire qui avait été mise par les
soins du conducteur sur le point le plus élevé de la
pointe de Vallières». Le nouveau mur se situe alors en
haut de l’actuelle rue de la Vigie sur la pointe de
Vallières, «les pilotes soussignés ayant
déclaré unanimement que le déplacement du
susdit amer de Vallières ne nuirait en rien à la
direction qu’il indique pour éviter le banc des Jeaux,
pourvu que sa nouvelle position se trouve bien dans la ligne
déterminée par le clocher de Saint-Pierre de
Royan.» La reconstruction du nouvel amer est engagée
l’année suivante. Un magnifique plan de la pointe de
Vallières, rehaussé de couleurs et datant de 1837 est
conservé dans le fonds du Service maritime aux archives
départementales de la Charente-Maritime permettant comme
l’indique sa légende de faire connaître la
position actuelle de l’amer de Vallières tant par
rapport à la jetée de Saint-Georges que par rapport
à l’emplacement de l’ancien amer. En 1853, le
mur doit être peint conformément à la
circulaire du ministre des Travaux Publics en date du 24 septembre.
La surface à blanchir est de 72 m2. Un tableau
dressé par l’ingénieur de la subdivision de la
Gironde, chargé de dresser un inventaire exhaustif des amers
de l’estuaire, indique en 1854 que l’amer de
Vallières, décrit comme une muraille en pierres de
taille, fait partie des cinq principaux amers de cette côte
de Gironde pour aider les navigateurs. Les autres points de
repères sont, d’ouest en est, l’amer de Terre
Nègre (tour en maçonnerie), le clocher de
l’ancienne église de Saint-Palais, l’amer du
Chai (tour en maçonnerie) et le clocher de
l’église de Royan. En 1869, un fort coup de vent
renverse l’amer. Il est aussitôt reconstruit
grâce au budget affecté au service du balisage de la
Gironde, preuve s’il en est que ce mur est important pour les
pilotes de l’estuaire. Le registre de balisage, dressé
en 1891, par l’ingénieur ordinaire des Ponts &
Chaussées, département des Phares et Balises de
l’arrondissement de Royan, et conservé aux archives
départementales, présente l’inventaire des
différents balisages le long de la rive droite de la Gironde
sous la forme d’un très joli cahier de dessins des
différentes balises et amers présents sur ces
côtes. Le mur de Vallières et ses dimensions y sont
 soigneusement représentés. Le registre de
balisage nous indique que «l’ouvrage consiste dans un
simple mur en maçonnerie blanchi à la laitance de
chaux. Il a 1,30 m d’épaisseur à la base et
0,40 m au sommet… La hauteur du mur étant à
6,50 m. Vu de face, ce mur présente un rectangle de 5
mètres sur 5 surmonté d’une partie triangulaire
de 1m50 de hauteur en forme de pignon.» Les frais
réguliers d’entretien consistent en
crépissages, rejointoiements et badigeonnages. Le registre
permet d’apprendre l’historique du balisage dans la
partie charentaise de la Gironde au cours du xixe siècle. En
1825, les rares balises ne permettent que la navigation de jour. La
navigation de nuit est possible par la passe du nord en 1853. En
1860, les navires peuvent aller de nuit jusqu’à
Pauillac. Il faut attendre 1892 pour que le balisage et
l’éclairage de la Gironde soient à peu
près complets. Toutes ces informations sont reprises sur les
cartes marines dressées au xixe siècle et mises
régulièrement à jour. Celle «De la
pointe de la Coubre à la pointe de la Négade,
embouchure de la Gironde» du Service hydrographique de la
marine, revue après une reconnaissance en 1912, indique
toujours le «Mur Blanchi» de l’amer sur la pointe
de Vallières. L’amer traverse la première
partie du xxe siècle sans dommage, épargné
notamment par les bombardements lors de la Seconde Guerre
mondiale.
soigneusement représentés. Le registre de
balisage nous indique que «l’ouvrage consiste dans un
simple mur en maçonnerie blanchi à la laitance de
chaux. Il a 1,30 m d’épaisseur à la base et
0,40 m au sommet… La hauteur du mur étant à
6,50 m. Vu de face, ce mur présente un rectangle de 5
mètres sur 5 surmonté d’une partie triangulaire
de 1m50 de hauteur en forme de pignon.» Les frais
réguliers d’entretien consistent en
crépissages, rejointoiements et badigeonnages. Le registre
permet d’apprendre l’historique du balisage dans la
partie charentaise de la Gironde au cours du xixe siècle. En
1825, les rares balises ne permettent que la navigation de jour. La
navigation de nuit est possible par la passe du nord en 1853. En
1860, les navires peuvent aller de nuit jusqu’à
Pauillac. Il faut attendre 1892 pour que le balisage et
l’éclairage de la Gironde soient à peu
près complets. Toutes ces informations sont reprises sur les
cartes marines dressées au xixe siècle et mises
régulièrement à jour. Celle «De la
pointe de la Coubre à la pointe de la Négade,
embouchure de la Gironde» du Service hydrographique de la
marine, revue après une reconnaissance en 1912, indique
toujours le «Mur Blanchi» de l’amer sur la pointe
de Vallières. L’amer traverse la première
partie du xxe siècle sans dommage, épargné
notamment par les bombardements lors de la Seconde Guerre
mondiale.
Au début des années 50, l’amer de Vallières donne avec le feu de Suzac l’alignement à 121°. Mais en raison du développement de la signalisation lumineuse dans l’entrée de la Gironde, ce repère n’est plus utilisé. La navigation suit la route de bouée à bouée, au lieu d’utiliser les alignements à terre, qui, comme le précise un rapport des Phares et Balises, sont plus ou moins visibles en raison des modifications d’aspect de la côte.
Des changements de l’état du balisage du littoral de la Charente-Maritime sont décidés en 1954 par la direction des Phares & Balises. Certains amers ne sont dorénavant plus entretenus en tant que marques de signalisation maritime. L’amer de Vallières figure sur cette liste et est officiellement déclassé.
Pour autant, la carte marine remise à jour en 1961 informe encore de la présence du mur. Mais l’urbanisation de la pointe a condamné l’amer qui n’est désormais plus visible depuis la mer.
Christophe Bertaud
Légendes des photos (de haut en bas)
Le clocher de Saint-Pierre de Royan servant d’amer est peint en blanc et noir. Son alignement avec l’amer de Vallières permet d’indiquer un banc de sable sur la Gironde. Cet amer est déclassé par le service des phares et Balises en 1914. (Collection particulière C. Bertaud)
Dessin du mur de l’amer dans le registre de balisage datant de 1891, coupe longitudinale (Archives départementales de la Charente-Maritime, S 8440)
Plan de 1837 indiquant l’emplacement du nouvel amer de Vallières construit en 1832 (Archives Départementales de la Charente-Maritime, S 8434)
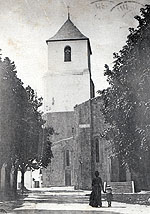 Repère fixe sur la côte, identifiable et
identifié, l’amer est utilisé par les
navigateurs pour se repérer d’assez près
pendant le jour et ainsi reconnaître ou rectifier une
position géographique. Il est au jour ce que le phare est
à la nuit. Les amers constituent un des trois types de
balisage du littoral avec les balises et les bouées. On en
distingue trois types. Le premier consiste en des repères
naturels tels de grands arbres ou des rochers de forme atypique. Le
second type d’amer est un objet artificiel souvent
remarquable par sa dimension, facilement identifiable pendant le
jour pour le navigateur et apte à caractériser une
partie de la côte mais n’ayant pas cette fonction
principale. Ce sont par exemple les clochers
d’églises.
Repère fixe sur la côte, identifiable et
identifié, l’amer est utilisé par les
navigateurs pour se repérer d’assez près
pendant le jour et ainsi reconnaître ou rectifier une
position géographique. Il est au jour ce que le phare est
à la nuit. Les amers constituent un des trois types de
balisage du littoral avec les balises et les bouées. On en
distingue trois types. Le premier consiste en des repères
naturels tels de grands arbres ou des rochers de forme atypique. Le
second type d’amer est un objet artificiel souvent
remarquable par sa dimension, facilement identifiable pendant le
jour pour le navigateur et apte à caractériser une
partie de la côte mais n’ayant pas cette fonction
principale. Ce sont par exemple les clochers
d’églises.Enfin, il y a la construction de monuments ayant comme unique fonction l’aide à la navigation. C’est précisément ce type de construction auquel correspond l’amer de Vallières édifié au cours de la première moitié du xixe siècle. C’est durant cette période que les côtes de France sont méthodiquement sondées afin de déterminer avec précision les chenaux de navigation, repérer les hauts-fonds et par là même mieux les baliser ou les éclairer. Cette gigantesque tâche incombe à Beautemps-Beaupré qui, à partir de 1816, commence l’étude complète de l'hydrographie des côtes françaises. Il aura fallu attendre la Révolution française pour qu’une administration particulière soit créée le 15 septembre 1792 avec la surveillance des phares, amers, et balises dépendant du ministère de la Marine. Mais la fréquentation de plus en plus importante des routes maritimes incite Napoléon ier à confier ce travail à un service spécifique de la Direction générale des Ponts & Chaussées, le bureau des phares et balises, créé à cette fin le 7 mars 1806. C’est dans ce contexte général d’amélioration du balisage des côtes et des estuaires que se réunit le 28 juin 1823 sous l’autorité du préfet une Commission d’officiers désignés par M. le Contre Amiral Commandant de la Marine du département de Rochefort. Ils sont chargés d’examiner les demandes des pilotes des stations de Royan et de Saint-Georges qui réclament «la construction d’un pan de mur à la place des ruines de l’ancien corps de garde de la pointe de Vallière» permettant de mieux caractériser la côte et d’aider à la navigation souvent difficile à cet endroit. La Commission reconnaît le bien fondé d’une telle requête et décide qu’un mur serait établi «dans la direction ouest- sud-ouest et est-nord-est sur l’emplacement de l’ancien corps de garde écroulé et aurait 4 mètres de largeur sur 5 mètres de hauteur au sommet du fronton.» Un amer répondant à cette description est érigé au lieu convenu mais ses dimensions et son orientation se révèlent mal évaluées et inadaptées. Il ne remplit pas efficacement ses fonctions d’aide à la navigation dans cette partie de la Gironde. C’est pourquoi, une nouvelle commission se réunit le 21 novembre 1827 sous la présidence du conducteur de la subdivision de Royan et en présence de pilotes des deux stations de Royan et de Saint-Georges ainsi que du maître de port de Royan. Elle examine le projet d’un surhaussement de 5 mètres à faire en charpente à l’amer de Vallières dans le but de le rendre plus visible. Les pilotes des différentes stations déclarent alors que «par ce surhaussement, le-dit amer acquerrait une hauteur assez considérable pour dominer les terres qui l’avoisinent et parmi lesquelles il paraît à peine, mais que la direction de sa façade restant la même, elle n’offrirait pas assez de développement pour être aperçue de très loin parce que la dite façade n’étant pas assez incliné de l’est dans le sud on ne peut, étant dans le haut de la rivière, qu’en apercevoir une petite partie.»
 Ils réclament la construction d’un nouvel amer
à la pointe de Vallières sur un nouvel emplacement.
L’amer projeté doit être suffisamment
élevé à une hauteur totale de 8 mètres,
que le côté est de sa façade soit porté
de 30° plus dans la direction du sud et enfin que les
dimensions de la-dite façade dans sa nouvelle direction soit
plus large de deux mètres pour atteindre six mètres
de largeur. Une décision tarde à venir et il faut
attendre quatre années pour qu’une nouvelle commission
se réunisse afin de définir l’emplacement et le
lieu précis du nouvel amer. Cette rencontre a lieu le 24 mai
1831 et définit «l’emplacement à adopter
lequel emplacement nous avons trouvé convenablement
situé à l’endroit où est placée
une balise provisoire qui avait été mise par les
soins du conducteur sur le point le plus élevé de la
pointe de Vallières». Le nouveau mur se situe alors en
haut de l’actuelle rue de la Vigie sur la pointe de
Vallières, «les pilotes soussignés ayant
déclaré unanimement que le déplacement du
susdit amer de Vallières ne nuirait en rien à la
direction qu’il indique pour éviter le banc des Jeaux,
pourvu que sa nouvelle position se trouve bien dans la ligne
déterminée par le clocher de Saint-Pierre de
Royan.» La reconstruction du nouvel amer est engagée
l’année suivante. Un magnifique plan de la pointe de
Vallières, rehaussé de couleurs et datant de 1837 est
conservé dans le fonds du Service maritime aux archives
départementales de la Charente-Maritime permettant comme
l’indique sa légende de faire connaître la
position actuelle de l’amer de Vallières tant par
rapport à la jetée de Saint-Georges que par rapport
à l’emplacement de l’ancien amer. En 1853, le
mur doit être peint conformément à la
circulaire du ministre des Travaux Publics en date du 24 septembre.
La surface à blanchir est de 72 m2. Un tableau
dressé par l’ingénieur de la subdivision de la
Gironde, chargé de dresser un inventaire exhaustif des amers
de l’estuaire, indique en 1854 que l’amer de
Vallières, décrit comme une muraille en pierres de
taille, fait partie des cinq principaux amers de cette côte
de Gironde pour aider les navigateurs. Les autres points de
repères sont, d’ouest en est, l’amer de Terre
Nègre (tour en maçonnerie), le clocher de
l’ancienne église de Saint-Palais, l’amer du
Chai (tour en maçonnerie) et le clocher de
l’église de Royan. En 1869, un fort coup de vent
renverse l’amer. Il est aussitôt reconstruit
grâce au budget affecté au service du balisage de la
Gironde, preuve s’il en est que ce mur est important pour les
pilotes de l’estuaire. Le registre de balisage, dressé
en 1891, par l’ingénieur ordinaire des Ponts &
Chaussées, département des Phares et Balises de
l’arrondissement de Royan, et conservé aux archives
départementales, présente l’inventaire des
différents balisages le long de la rive droite de la Gironde
sous la forme d’un très joli cahier de dessins des
différentes balises et amers présents sur ces
côtes. Le mur de Vallières et ses dimensions y sont
Ils réclament la construction d’un nouvel amer
à la pointe de Vallières sur un nouvel emplacement.
L’amer projeté doit être suffisamment
élevé à une hauteur totale de 8 mètres,
que le côté est de sa façade soit porté
de 30° plus dans la direction du sud et enfin que les
dimensions de la-dite façade dans sa nouvelle direction soit
plus large de deux mètres pour atteindre six mètres
de largeur. Une décision tarde à venir et il faut
attendre quatre années pour qu’une nouvelle commission
se réunisse afin de définir l’emplacement et le
lieu précis du nouvel amer. Cette rencontre a lieu le 24 mai
1831 et définit «l’emplacement à adopter
lequel emplacement nous avons trouvé convenablement
situé à l’endroit où est placée
une balise provisoire qui avait été mise par les
soins du conducteur sur le point le plus élevé de la
pointe de Vallières». Le nouveau mur se situe alors en
haut de l’actuelle rue de la Vigie sur la pointe de
Vallières, «les pilotes soussignés ayant
déclaré unanimement que le déplacement du
susdit amer de Vallières ne nuirait en rien à la
direction qu’il indique pour éviter le banc des Jeaux,
pourvu que sa nouvelle position se trouve bien dans la ligne
déterminée par le clocher de Saint-Pierre de
Royan.» La reconstruction du nouvel amer est engagée
l’année suivante. Un magnifique plan de la pointe de
Vallières, rehaussé de couleurs et datant de 1837 est
conservé dans le fonds du Service maritime aux archives
départementales de la Charente-Maritime permettant comme
l’indique sa légende de faire connaître la
position actuelle de l’amer de Vallières tant par
rapport à la jetée de Saint-Georges que par rapport
à l’emplacement de l’ancien amer. En 1853, le
mur doit être peint conformément à la
circulaire du ministre des Travaux Publics en date du 24 septembre.
La surface à blanchir est de 72 m2. Un tableau
dressé par l’ingénieur de la subdivision de la
Gironde, chargé de dresser un inventaire exhaustif des amers
de l’estuaire, indique en 1854 que l’amer de
Vallières, décrit comme une muraille en pierres de
taille, fait partie des cinq principaux amers de cette côte
de Gironde pour aider les navigateurs. Les autres points de
repères sont, d’ouest en est, l’amer de Terre
Nègre (tour en maçonnerie), le clocher de
l’ancienne église de Saint-Palais, l’amer du
Chai (tour en maçonnerie) et le clocher de
l’église de Royan. En 1869, un fort coup de vent
renverse l’amer. Il est aussitôt reconstruit
grâce au budget affecté au service du balisage de la
Gironde, preuve s’il en est que ce mur est important pour les
pilotes de l’estuaire. Le registre de balisage, dressé
en 1891, par l’ingénieur ordinaire des Ponts &
Chaussées, département des Phares et Balises de
l’arrondissement de Royan, et conservé aux archives
départementales, présente l’inventaire des
différents balisages le long de la rive droite de la Gironde
sous la forme d’un très joli cahier de dessins des
différentes balises et amers présents sur ces
côtes. Le mur de Vallières et ses dimensions y sont
 soigneusement représentés. Le registre de
balisage nous indique que «l’ouvrage consiste dans un
simple mur en maçonnerie blanchi à la laitance de
chaux. Il a 1,30 m d’épaisseur à la base et
0,40 m au sommet… La hauteur du mur étant à
6,50 m. Vu de face, ce mur présente un rectangle de 5
mètres sur 5 surmonté d’une partie triangulaire
de 1m50 de hauteur en forme de pignon.» Les frais
réguliers d’entretien consistent en
crépissages, rejointoiements et badigeonnages. Le registre
permet d’apprendre l’historique du balisage dans la
partie charentaise de la Gironde au cours du xixe siècle. En
1825, les rares balises ne permettent que la navigation de jour. La
navigation de nuit est possible par la passe du nord en 1853. En
1860, les navires peuvent aller de nuit jusqu’à
Pauillac. Il faut attendre 1892 pour que le balisage et
l’éclairage de la Gironde soient à peu
près complets. Toutes ces informations sont reprises sur les
cartes marines dressées au xixe siècle et mises
régulièrement à jour. Celle «De la
pointe de la Coubre à la pointe de la Négade,
embouchure de la Gironde» du Service hydrographique de la
marine, revue après une reconnaissance en 1912, indique
toujours le «Mur Blanchi» de l’amer sur la pointe
de Vallières. L’amer traverse la première
partie du xxe siècle sans dommage, épargné
notamment par les bombardements lors de la Seconde Guerre
mondiale.
soigneusement représentés. Le registre de
balisage nous indique que «l’ouvrage consiste dans un
simple mur en maçonnerie blanchi à la laitance de
chaux. Il a 1,30 m d’épaisseur à la base et
0,40 m au sommet… La hauteur du mur étant à
6,50 m. Vu de face, ce mur présente un rectangle de 5
mètres sur 5 surmonté d’une partie triangulaire
de 1m50 de hauteur en forme de pignon.» Les frais
réguliers d’entretien consistent en
crépissages, rejointoiements et badigeonnages. Le registre
permet d’apprendre l’historique du balisage dans la
partie charentaise de la Gironde au cours du xixe siècle. En
1825, les rares balises ne permettent que la navigation de jour. La
navigation de nuit est possible par la passe du nord en 1853. En
1860, les navires peuvent aller de nuit jusqu’à
Pauillac. Il faut attendre 1892 pour que le balisage et
l’éclairage de la Gironde soient à peu
près complets. Toutes ces informations sont reprises sur les
cartes marines dressées au xixe siècle et mises
régulièrement à jour. Celle «De la
pointe de la Coubre à la pointe de la Négade,
embouchure de la Gironde» du Service hydrographique de la
marine, revue après une reconnaissance en 1912, indique
toujours le «Mur Blanchi» de l’amer sur la pointe
de Vallières. L’amer traverse la première
partie du xxe siècle sans dommage, épargné
notamment par les bombardements lors de la Seconde Guerre
mondiale.Au début des années 50, l’amer de Vallières donne avec le feu de Suzac l’alignement à 121°. Mais en raison du développement de la signalisation lumineuse dans l’entrée de la Gironde, ce repère n’est plus utilisé. La navigation suit la route de bouée à bouée, au lieu d’utiliser les alignements à terre, qui, comme le précise un rapport des Phares et Balises, sont plus ou moins visibles en raison des modifications d’aspect de la côte.
Des changements de l’état du balisage du littoral de la Charente-Maritime sont décidés en 1954 par la direction des Phares & Balises. Certains amers ne sont dorénavant plus entretenus en tant que marques de signalisation maritime. L’amer de Vallières figure sur cette liste et est officiellement déclassé.
Pour autant, la carte marine remise à jour en 1961 informe encore de la présence du mur. Mais l’urbanisation de la pointe a condamné l’amer qui n’est désormais plus visible depuis la mer.
Christophe Bertaud
Légendes des photos (de haut en bas)
Le clocher de Saint-Pierre de Royan servant d’amer est peint en blanc et noir. Son alignement avec l’amer de Vallières permet d’indiquer un banc de sable sur la Gironde. Cet amer est déclassé par le service des phares et Balises en 1914. (Collection particulière C. Bertaud)
Dessin du mur de l’amer dans le registre de balisage datant de 1891, coupe longitudinale (Archives départementales de la Charente-Maritime, S 8440)
Plan de 1837 indiquant l’emplacement du nouvel amer de Vallières construit en 1832 (Archives Départementales de la Charente-Maritime, S 8434)
Commentaires des internautes
Il n'y a pas de commentaire.
+ ajouter un commentaire
Commentaires
Courrier des lecteurs
L’association Les Amis des chiens de Saint-Palais et Vaux-sur-Mer nous ont adressé un droit de réponse à la suite de l’article paru dans le numéro 151 concernant les déjections canines sur la plage.
 Le Journal des Propriétaires
Le Journal des Propriétaires
